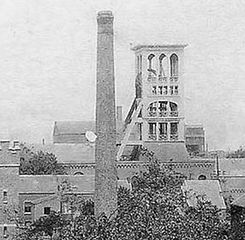Charles Tournay


Cet article ne s'appuie pas, ou pas assez, sur des sources secondaires ou tertiaires ().
Pour améliorer la vérifiabilité de l'article ainsi que son intérêt encyclopédique, il est nécessaire, quand des sources primaires sont citées, de les associer à des analyses faites par des sources secondaires.

Pour les articles homonymes, voir Charles Tournay (homonymie) et Tournay.
| Décès | Puits Ricard à La Grand-Combe |
|---|---|
| Nationalité |  Belgique Belgique |
| Profession | Ingénieur et architecte |
modifier 
Charles Tournay (né à une date inconnue et mort au puits Ricard à La Grand-Combe en 1939) est un ingénieur et architecte industriel belge spécialisé dans la construction de chevalements en béton armé, qu'il a édifiés dans plusieurs pays d'Europe. Il est le fondateur de la « Société coopérative Charles Tournay ».
Biographie
Charles Tournay est originaire de la région de Liège, en Belgique où il exerce le métier d'ingénieur et d’architecte. Il meurt en 1939 à La Grand-Combe d'une chute depuis le chevalement du puits Ricard qui est alors en cours de construction[1].
Société coopérative Charles Tournay
Charles Tournay crée une entreprise qui porte son nom. Cet ingénieur s'est spécialisé dans les structures en béton armé, notamment les chevalements. Il est l'instigateur de la construction du premier chevalement de ce type en 1914 au puits no 5 du Hasard à Micheroux[1]. En 1920, il conçoit un modèle de chevalement pour la Compagnie des mines d'Anzin qui est édifié sur cinq charbonnages : les fosses Dutemple, Renard, Hérin, Saint-Mark et Haveluy[2], ce modèle a également servi à la construction du puits San Vincente au Portugal en 1935[3]. Il conçoit également des chevalements qui sont par la suite devenus des monuments historiques comme les chevalements du puits de la fosse no 2 des mines de Flines[4], du puits Sainte-Marie[5], du puits de Sauwartan où du puits Ricard[6].
-
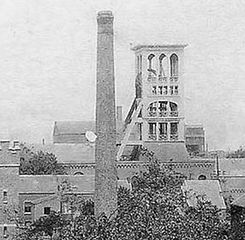 Le chevalement du no 5 des mines de Micheroux (1914).
Le chevalement du no 5 des mines de Micheroux (1914). - Le chevalement du puits Dutemple no 2 (1920).
- Le chevalement du puits no 2 des mines de Flines (1922).
-
 Le chevalement du puits Sainte-Marie (1924).
Le chevalement du puits Sainte-Marie (1924). - Le chevalement du puits de Sauwartan (1928).
-
 Le chevalement du puits Ricard (1939).
Le chevalement du puits Ricard (1939).
Les chevalements des puits Dutemple no 2 et de Flines no 2, en plus de leur inscription aux monuments historiques, sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial par l'Unesco depuis le , où ils constituent respectivement les sites nos 14 et 32[7].
Références
- ↑ a et b Pierre-Christian Guiollard 1993, p. 114.
- ↑ Pierre-Christian Guiollard 1993, p. 122.
- ↑ (es) « Puits San Vincente ».
- ↑ Pierre-Christian Guiollard 1993, p. 120.
- ↑ Pierre-Christian Guiollard 1993, p. 127
- ↑ Pierre-Christian Guiollard 1993, p. 126.
- ↑ « Bassin Minier Nord-Pas de Calais », sur whc.unesco.org, Unesco .
Voir aussi
Bibliographie
![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.
: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.
- Pierre-Christian Guiollard, Les Chevalements des houillères françaises, Fichous, Pierre-Christian Guiollard, , 268 p. (ISBN 2-9502503-6-X et 2-9502503-6-X).

Liens externes
- « Les Chevalements, beffrois de l'industrie minière : Les Chevalements en béton armé », sur mineur62.free.fr
 Portail de l’architecture et de l’urbanisme
Portail de l’architecture et de l’urbanisme  Portail de la Belgique
Portail de la Belgique  Portail du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais
Portail du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais  Portail du Gard
Portail du Gard  Portail des entreprises
Portail des entreprises